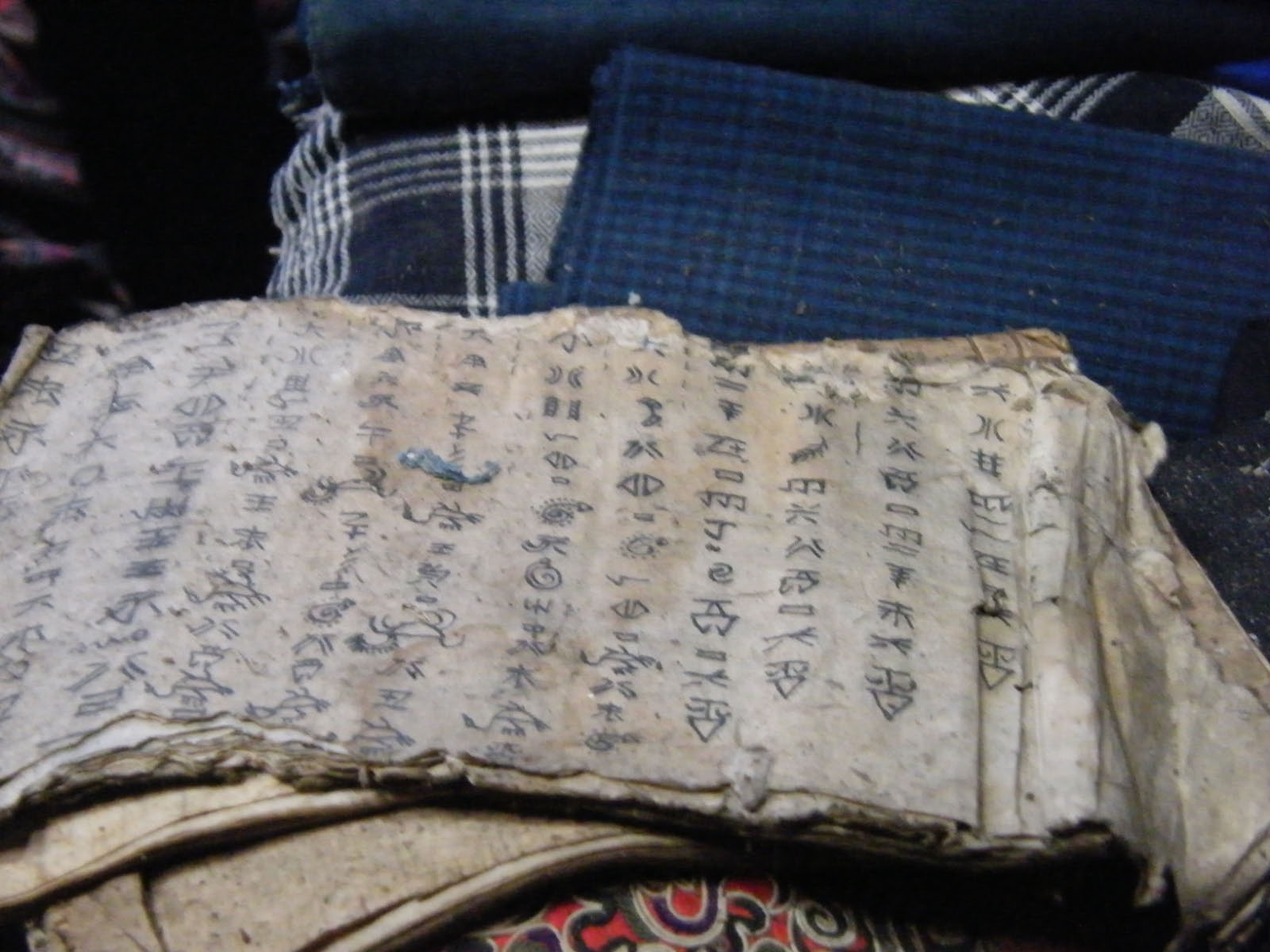Langues d'Asie
- Dravidienne
- Ouralo-altaïque
- Indo-européenne (comprenant en particulier en Asie : les langues indo-iraniennes dont font partie les langues Indo-aryennes)
- Sino Thaï (Sino tibétaine + Austro asiatique + Taï Kadai + Hmong-mein)
- Austronésienne
- Afro asiatique (Chamito sémitique)
Selon les spécialistes des considérations sur les regroupements de langues peuvent etre discutés comme suit
Divers regroupements entre les six familles identifiées ci-dessus ont été proposés au cours du siècle dernier. Presque toutes les combinaisons ont été essayées.
"Si on exclut l'hypothèse d'un Sino-indo-européen, encore très fragile (Pulleyblank 1996), quatre scénarios de quatre macro-familles sont aujourd'hui en discussion : Austro-Tai, Austrique, Sino-caucasien, Sino-austronésien (devenu récemment Sino-tibétain-austronésien).
En ce qui concerne l'Austro-Tai, Schlegel (1901) avait déjà noté des rapports entre les langues tai et les langues austronésiennes. Mais c'est Benedict qui a véritablement proposé, dès 1942, l'existence d'une macro-famille Austro-tai, comprenant deux branches : le tai-kadai et l'austronésien, auxquelles on a parfois ajouté le miao-yao. Cette hypothèse est aujourd'hui toujours défendue par Ostapirat (2001) et critiquée, entre autres, par Thurgood (1994)
.
L'Austrique est une hypothèse émise aussi il y a longtemps par Schmidt (1905) qui regroupait les familles Austro Asiatique et Austronésienne. Elle est aujourd'hui reprise par Blust (1996) et par Reid (1994). D'autres y ajoutent même le miao-yao et les langues tai-kadai. Diffloth (2001) pense que ces rapprochements sont loin d'être convaincants. Il situe par ailleurs le proto-Austro Asiatique très au sud du sous-continent de l'Asie du sud-est, voire en Inde même, ce qui rend l'hypothèse de l'Austrique assez invraisemblable.
Après avoir identifié des items lexicaux communs entre le Sino Tibétain, le caucasien du nord et le inénisséen (langue ket), Starostin propose au début des années 1980 l'existence d'une macro-famille, le Sino-caucasien (Starostin 1989). Plus tard, Bengston (1991) y ajoute le basque, le bouroushaski et le na-déné, pour en faire la macro-famille appelée par Ruhlen le Déné-caucasien.
Au début des années 1990, enfin, Sagart suggère que le chinois et l'austronésien soient apparentés (Sagart 1993) et affirme en conséquence l'existence d'une macro-famille, le Sino-austronésien, divisée en deux branches : les langues sinitiques et les langues austronésiennes. Le tibéto-birman est laissé de côté. Il revient aujourd'hui sur cette hypothèse en reconnaissant une intégrité au sino-tibétain (avec ses deux branches, langues sinitiques et langues Tibéto Birmane) et propose une nouvelle macro-famille : le Sino-tibétain-austronésien (STAN) (Sagart 2001a). Les langues tai-kadai sont aussi incluses dans le STAN, qui daterait de 6500 environ avant J.-C., au moment de la domestication des céréales dans la vallée du Fleuve jaune."